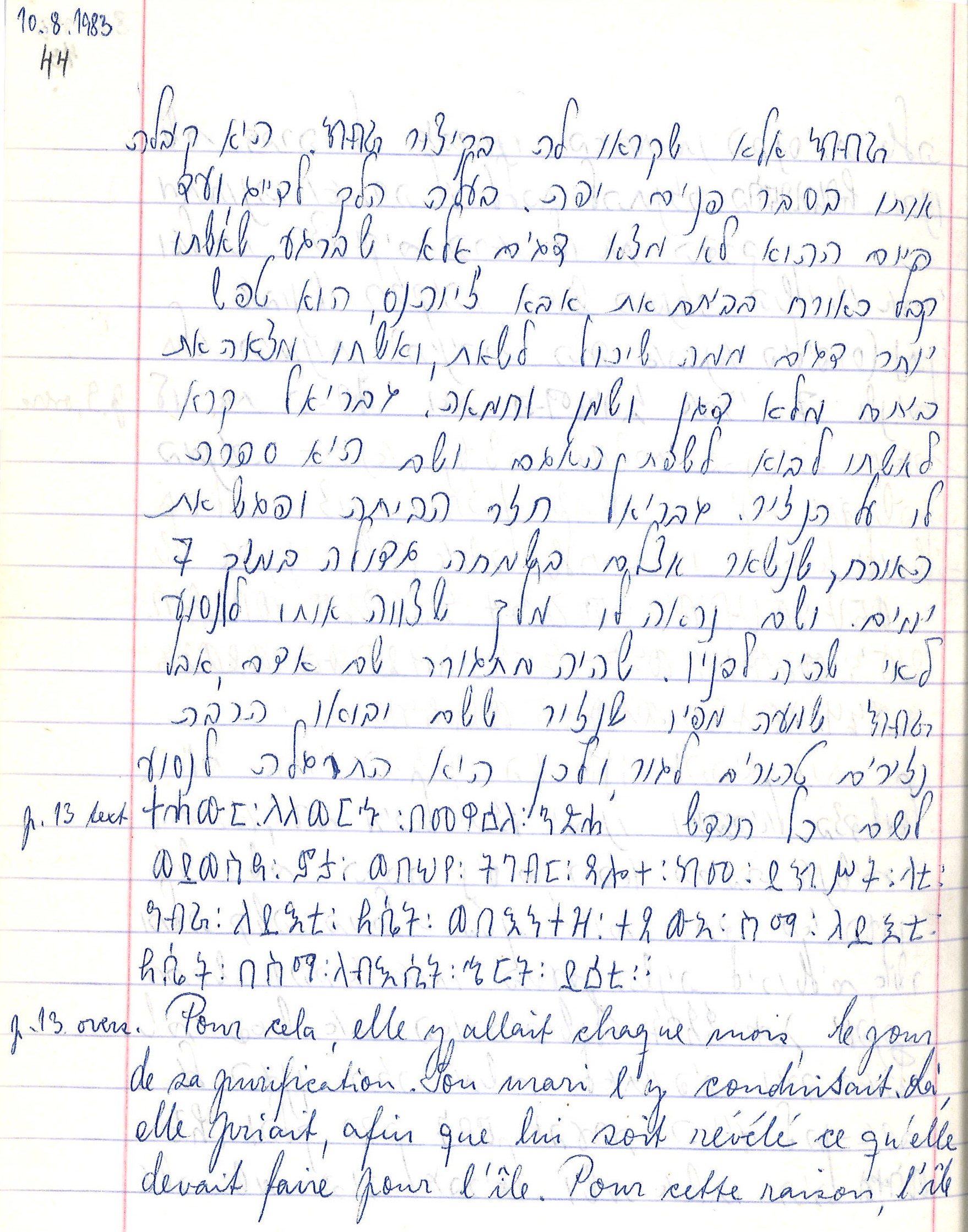Extrait du Journal Le Monde du 17 décembre 2023 – L’historienne Chloé Rosner retrace deux siècles d’archéologie en Palestine et Israël. Dans un entretien au « Monde », elle montre comment la discipline a constitué le ciment du projet sioniste visant à créer un Etat-nation, et comment elle continue aujourd’hui de susciter des débats aux enjeux multiples, moins scientifiques que politiques.
Propos recueillis par Youness Bousenna
Publié hier à 06h20
Dans Creuser la terre-patrie (CNRS Editions, 336 pages, 26 euros), l’historienne Chloé Rosner montre comment l’archéologie peut contribuer à bâtir une nation. Retraçant la trajectoire de cette discipline depuis la Palestine sous domination ottomane du XIXe siècle, cette postdoctorante à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) met en lumière comment le sionisme naissant a investi l’archéologie. Cet ouvrage, issu d’une thèse soutenue en 2020 à Sciences Po, souligne ainsi le rôle décisif de l’archéologie juive comme creuset de l’identité d’Israël.
Comment vivez-vous la situation actuelle en Israël, après des années à arpenter ce pays pour votre thèse d’histoire sur l’archéologie juive ?
La situation du terrain israélo-palestinien était déjà très sensible avant les attaques du Hamas le 7 octobre. En tant que chercheuse, il faut peser chaque mot employé et on y ressent une certaine pression, car les interlocuteurs attendent qu’on se positionne politiquement.
Cette actualité me convainc de la nécessité de la recherche pour montrer la complexité d’un sujet comme le sionisme, qu’on tend à traiter comme un mouvement monolithique, alors que l’histoire montre des évolutions et des lignes de fracture qui nécessiteraient de parler de « sionismes » au pluriel. Avec cette thèse, je voulais précisément explorer le rapport au territoire à travers l’archéologie, domaine où s’intriquent du mémoriel, du religieux et du politique.
En quoi « creuser la terre-patrie » a constitué un enjeu décisif tout au long de l’histoire moderne d’Israël ?
L’archéologie a joué un rôle majeur dans la construction du triptyque identité, culture et territoire, que ce soit dans le cadre du projet national sioniste puis lors des premières décennies d’édification de l’Etat d’Israël au début du XXe siècle. Historiquement, le mouvement sioniste se compose de juifs issus de pays et de cultures multiples, dont l’identité et le rapport au judaïsme diffèrent. L’archéologie est alors un moyen de se rassembler pour faire nation autour d’une mémoire commune matérialisée par des vestiges et ancrée sur le territoire palestinien puis israélien.
La discipline est envisagée comme un moyen de faire ressortir le passé juif afin de faire de la Palestine, habitée par un autre peuple, une terre-patrie – ce qui a pour conséquence d’ignorer les autres passés, mémoires ou traditions qui y sont associés. C’est ainsi que l’archéologie devient un enjeu, qui se poursuit après la création de l’Etat d’Israël en 1948.
Ce dernier cherchera ainsi à effacer les traces de la Palestine sous mandat britannique [ce territoire, longtemps intégré à l’Empire ottoman, est passé sous mandat colonial du Royaume-Uni en 1922] pour « israéliser » le territoire. L’archéologie va ainsi permettre de montrer que le peuple juif était uni, et que celui-ci a une existence historique qu’il s’agit de faire renaître.
L’archéologie de la « Terre sainte » débute bien avant le projet sioniste, dès le début du XIXe siècle. Comment émerge cette quête du passé ?
La campagne de Bonaparte en Egypte [1798-1801] constitue un moment pionnier : des scientifiques accompagnent les militaires, scellant un lien entre ambition impériale et science archéologique. Le Proche-Orient, qui constitue un enjeu stratégique, est simultanément perçu par les puissances européennes – France, Allemagne, Angleterre – comme le berceau des civilisations, dont la Palestine constitue l’épicentre par son caractère de Terre sainte. Chaque pays rêve alors de découvrir des antiquités prouvant la véracité du texte biblique : cette course archéologique comporte un enjeu de prestige, et a aussi pour effet de légitimer les visées coloniales.
Si l’archéologie se structure en tant que science dans la seconde moitié du XIXe siècle, on peut identifier trois grandes phases.
Dans la première moitié du XIXe siècle, ces missions sont le fait d’explorateurs ou de diplomates à titre individuel. Ainsi de la première fouille attribuée à l’aventurière britannique Lady Hester Stanhope [1776-1839] à Ascalon, en 1815, ou des explorations du théologien américain Edward Robinson [1794-1863], considéré comme le père de l’archéologie biblique.
La création du Palestine Exploration Fund par les Britanniques, en 1865, marque un tournant vers une institutionnalisation caractérisée par la fondation de sociétés savantes et de structures académiques. Désormais, l’archéologie se pratique avec des moyens humains et financiers de plus grande échelle.
Enfin, une dernière étape intervient avec la fondation d’institutions basées en Palestine, créant une nouvelle scène concentrée à Jérusalem. Chaque grand pays lance sa structure : l’Ecole pratique des études bibliques, aujourd’hui nommée Ecole biblique et archéologique française de Jérusalem, est créée en 1890 par le dominicain Marie-Joseph Lagrange [1855-1938] ; l’American School of Oriental Research est fondée en 1900, ainsi qu’un institut évangélique allemand, le Deutsches Evangelisches Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes. Ces structures témoignent d’une compétition pour préempter le terrain et mettre la main sur le plus d’objets possible.
Comment le mouvement sioniste naissant va-t-il lui aussi se joindre à cette dynamique archéologique ?
Avec l’émigration (aliya) de dizaines de milliers de juifs vers la Palestine, le sionisme est en plein essor au tournant du XXe siècle, dans le sillage de la parution d’Autoémancipation ! [1882], de Léon Pinsker [1821-1891], et de L’Etat des Juifs [1896], de Theodor Herzl [1860-1904].
Certains immigrés juifs sont attentifs à la scène archéologique de Jérusalem emmenée par les savants occidentaux et encadrée par les autorités ottomanes. Ces intellectuels sont à la fois intéressés par ces recherches et agacés par la passivité de leur communauté. Les promoteurs du sionisme veulent intégrer l’arène scientifique occidentale tout en luttant contre une approche christiano-centrée de la Palestine : pour eux, ce n’est pas la Terre sainte mais la terre-patrie, qu’il s’agit donc de faire passer du registre religieux au registre national.
Une figure comme Eliezer Ben Yehouda [1858-1922], père de l’hébreu moderne, témoigne de l’intérêt de la communauté juive de Palestine pour les avancées de cette archéologie, à travers des articles de presse où il opère la jonction entre nationalisme et connaissance de la terre-patrie, proposant la création d’un institut voué à l’étude de la « Terre d’Israël » (« Eretz Israël »). Il théorise en effet l’idée que, pour se revendiquer comme une nation civilisée selon les standards européens, les juifs doivent s’intéresser à leur passé et le valoriser.
Deux institutions décisives se créent à cette période : la Société pour la préservation des monuments historiques juifs, en 1912, qui entend répertorier et sauvegarder le patrimoine national, ainsi que la Société juive d’exploration de la Palestine[JPES], en 1913, destinée à explorer la « Terre d’Israël ».
Se mêle donc à la volonté de réagir aux avancées scientifiques en Palestine un objectif d’affirmation nationale. En 1913, le cofondateur de la JPES, Baruch Rosenstein [1881-1950], écrit un article où il évoque les fouilles comme une condition pour le succès de la colonisation sioniste, affirmant : « Nous devons approfondir notre connaissance de la nature du pays. » L’archéologie relie donc le passé au présent, mais prépare également le futur.
L’archéologie se trouvait donc au cœur de la construction nationale, avant même la création d’Israël…
Je me suis en particulier intéressée à deux fouilles considérées comme les premières de l’archéologie hébraïque, celles de Hammath-Tibériade et de Beit Alfa réalisées dans les années 1920 : un discours politique est immédiatement construit autour de celles-ci. Le récit autour de ces travailleurs qui exhument le passé juif pour construire la future nation est repris par la presse, couvert par des films et des photos.
Cette propagande active est notamment liée à la personnalité de ceux qui dirigent les fouilles, très enclins au sensationnalisme, à l’instar d’Eliezer Lipa Sukenik [1889-1953], l’un des premiers archéologues de l’université hébraïque de Jérusalem, créée en 1925. Plus qu’un mouvement homogène, l’archéologie hébraïque se développe au gré des individus, de leurs réseaux et des circonstances.
La création de l’Etat d’Israël, en mai 1948, provoque-t-elle un bouleversement de l’archéologie juive ?
Si les enjeux ne changent pas, l’indépendance pose deux grands défis. La gestion administrative, d’abord : le nouvel Etat va créer un département israélien des antiquités et des musées, reprenant la structure existant durant le mandat britannique et certains de ses employés.
Simultanément, le premier chef du gouvernement, David Ben Gourion [1886-1973], s’empare de l’archéologie pour façonner la société israélienne. Il est en particulier captivé par l’archéologie biblique, et dresse des ponts entre l’Israël biblique et son temps, promouvant par exemple la figure de Josué comme modèle de combattant dont il faut s’inspirer. L’archéologie biblique va ainsi devenir de plus en plus centrale. Cette orientation entre archéologie et politique se confirme avec le deuxième président, Isaac Ben Zvi [1884-1963], qui était lui-même membre de la JPES, renommée Israel Exploration Society.
Au-delà des institutions, vous évoquez l’ancrage dans la société israélienne d’une « archéologie nationale participative ». Quels sont ses contours ?
L’archéologie est profondément ancrée dans la culture et la société israéliennes. Cette archéologie nationale participative s’inscrit dans les stratégies identitaires développées par le gouvernement comme réponse aux enjeux du présent, tels que la pluralité des origines des citoyens juifs. Ainsi, tous les citoyens sont invités à participer à la mise au jour de vestiges : beaucoup contribuent par exemple à des fouilles durant leur service militaire.
L’archéologie fait ainsi figure de sport national, qui a pour effet d’inculquer une identité nationale ancrée dans un passé concret. L’aspiration à la pratique de l’archéologie a pour objectif sous-jacent l’affirmation des juifs comme formant la nation originelle de la « Terre d’Israël ».
Cette affirmation d’identité passe aussi par la mise en tourisme, soulignez-vous…
La mise en tourisme des sites archéologiques, tout comme les musées et les collections locales, est un autre moyen d’inscrire des messages symboliques et historiques dans l’espace. Le tourisme archéologique naît dès le XIXe siècle. Le sionisme s’en empare comme un moyen d’exhumer un passé juif justifiant ses aspirations. Les sites archéologiques sont ainsi visités lors de séjours touristiques aux côtés d’infrastructures sionistes, permettant de créer des ponts entre le passé juif et les avancées du sionisme en Palestine.
Des vestiges antiques sont aussi visités lors de randonnées organisées par des syndicats sionistes ou des écoles hébraïques, permettant de rendre le territoire familier et de naturaliser une identité nationale. Après 1948, cette mise en tourisme des sites s’accentue, avec la création de musées partout sur le territoire.
Ainsi, en 1967, cent quarante musées dont soixante-quinze dédiés aux antiquités sont recensés à travers le pays. Cette historicisation du territoire permet d’inculquer une conscience historique aux immigrés récents pour qu’ils puissent se revendiquer comme des citoyens israéliens. L’archéologie devient ainsi le creuset de la nation.
Cet investissement de l’archéologie se fait-il au détriment de l’objectivité scientifique ? Le cas du palais de David, mentionné dans la Bible, par exemple, suscite un vif débat : des archéologues affirment en avoir trouvé des vestiges, quand d’autres assurent que c’est très improbable…
Lors de mes recherches, je n’ai pas véritablement abordé ce sujet, qui nécessite un regard d’archéologue ou d’historien spécialisé dans les périodes concernées. Mon travail vise à plonger dans les trajectoires personnelles et professionnelles des acteurs qui se sont investis dans l’archéologie, à interroger les différents rouages qui conduisent à la mise en place de la fouille d’un site, jusqu’à sa patrimonialisation.
Cependant, dans le cas du lieu identifié à l’emplacement de la « cité de David » [sur la colline de l’Ophel, au pied de la Vieille Ville de Jérusalem], il me semble qu’une part de sensationnel lié à son association avec le récit biblique s’ajoute aux enjeux politiques et idéologiques qui entourent son étude archéologique – ainsi que sa mise en tourisme.
Le site de l’Ophel fait l’objet d’une fascination dès les premiers temps de l’archéologie au XIXe siècle, mais aussi d’une compétition entre les Français, notamment sous l’impulsion de la famille Rothschild, et les Britanniques, pour mettre au jour la Jérusalem biblique. Ce site est tellement convoité que, dès la mise en place du mandat, les autorités britanniques font appel aux différentes institutions investies dans l’archéologie afin d’engager une fouille partagée.
Ce geste apparaît comme un moyen de ne pas donner l’impression qu’ils souhaitent s’approprier un site biblique valorisé comme « universel ». Ce type d’anecdotes témoigne des multiples strates d’enjeux politiques et religieux associées à ce site au cours de l’histoire.
Quid des influences étrangères aujourd’hui sur l’archéologie en Israël ?
Cette question – liée à celle des financements étrangers – est toujours d’actualité et continue de susciter des débats parmi les archéologues, comme le montrent ceux provoqués l’été dernier après l’annonce d’un possible prêt d’une antique mosaïque chrétienne du site de Megiddo au Musée de la Bible, à Washington, lié à d’influentes organisations et personnalités chrétiennes évangéliques américaines [la controverse portant, entre autres, sur le profil de ce musée à la réputation sulfureuse et sur sa capacité à préserver la mosaïque dans de bonnes conditions].
L’intérêt d’institutions chrétiennes étrangères pour la mise au jour des traces du passé de la Terre sainte, avec pour objectif sous-jacent de prouver la véracité du texte biblique et de répondre à leurs propres agendas politiques, trouve ses origines au XIXe siècle. J’insiste sur ce regard historique, car il me semble être utile pour mieux comprendre les enjeux d’aujourd’hui.
C’est d’ailleurs cette actualité archéologique, cette multiplicité d’annonces de découvertes et de débats et l’omniprésence de ces sujets dans l’espace public, dans la presse locale, internationale ou sur les réseaux sociaux, qui m’ont poussée à vouloir mieux saisir l’histoire sociale, politique et culturelle, sur la longue durée, de cette discipline dans la région.
Creuser la terre-patrie. Une histoire de l’archéologie en Palestine-Israël, de Chloé Rosner, CNRS Editions, 336 p., 26 €.